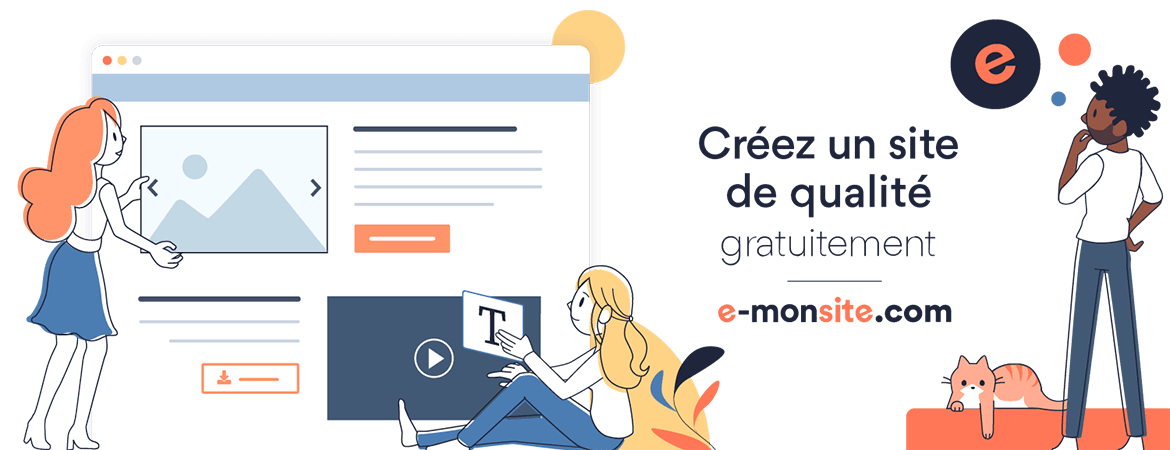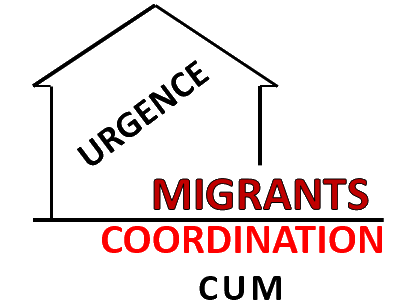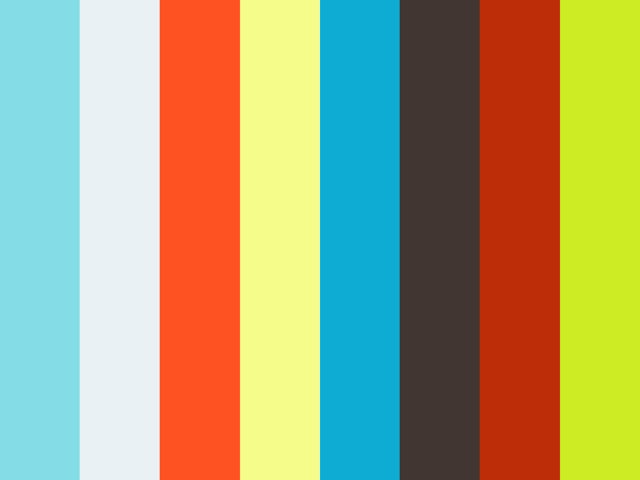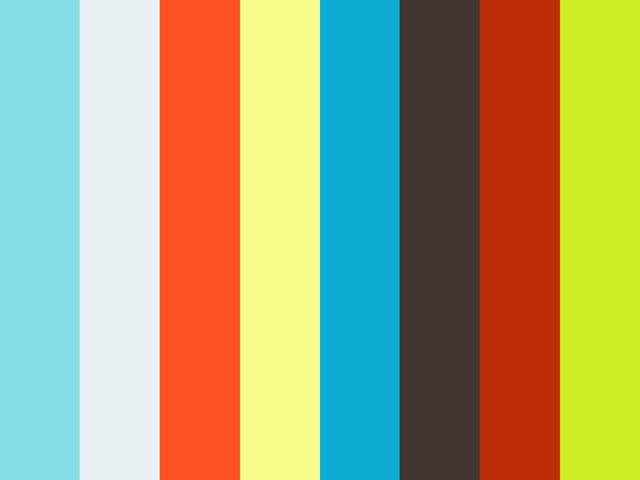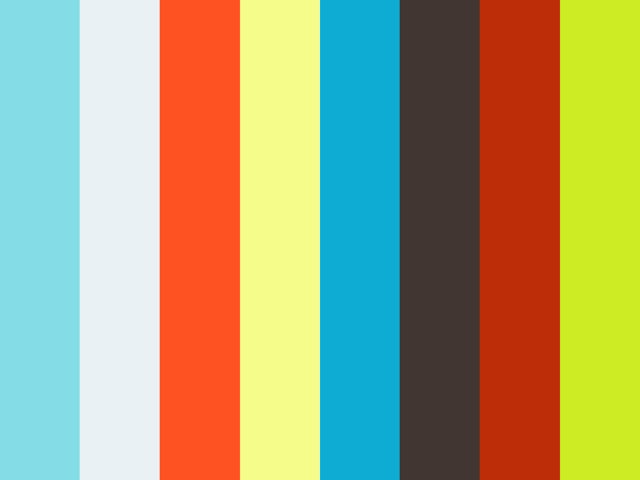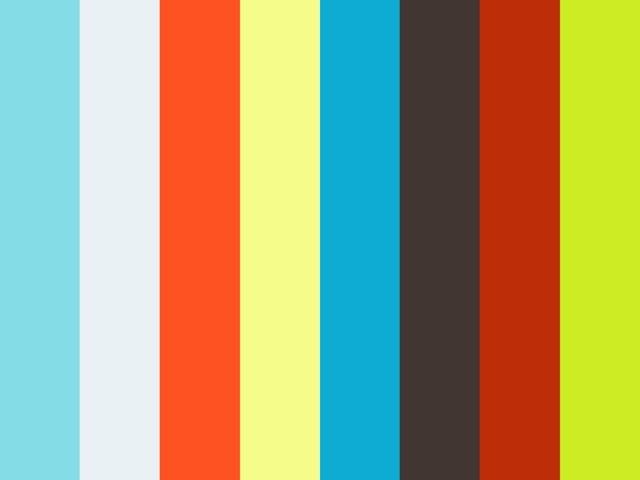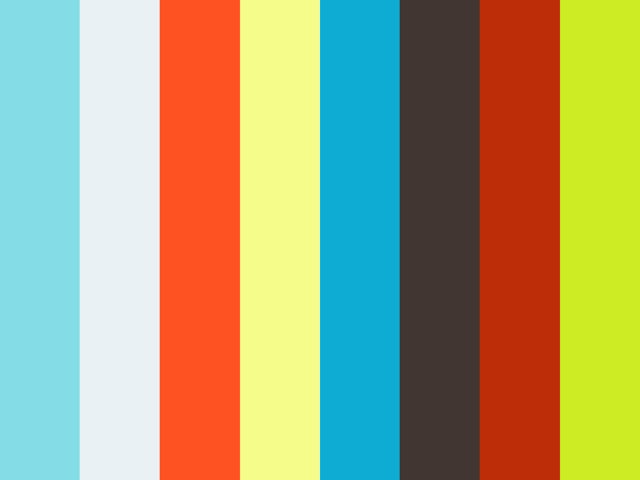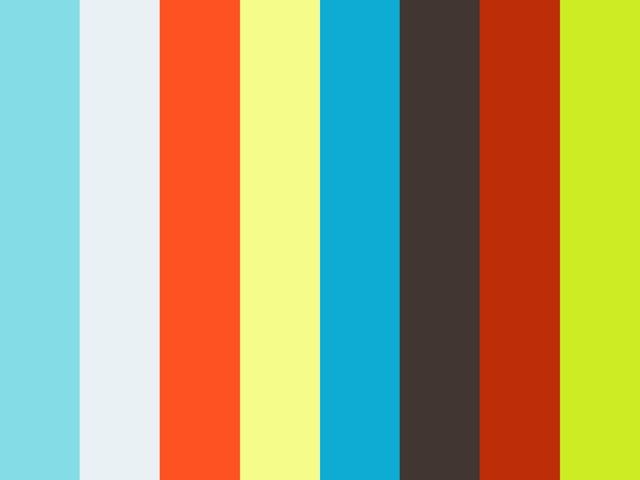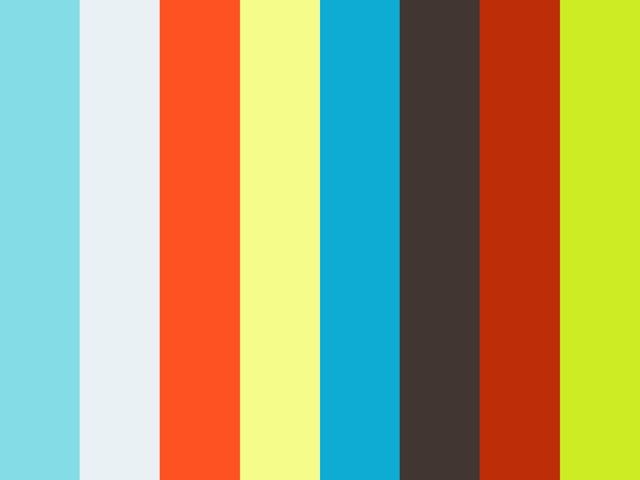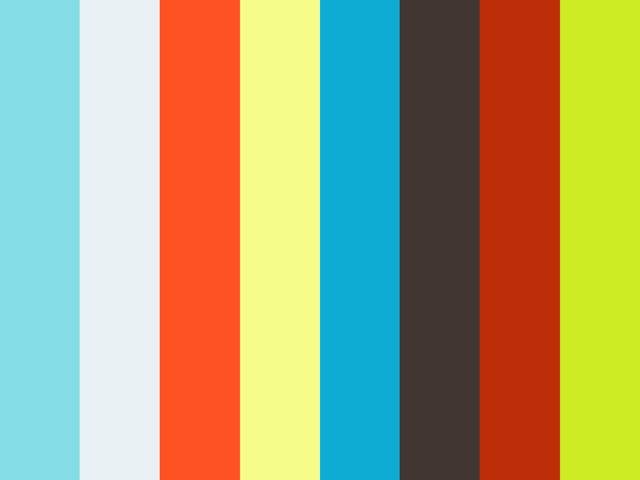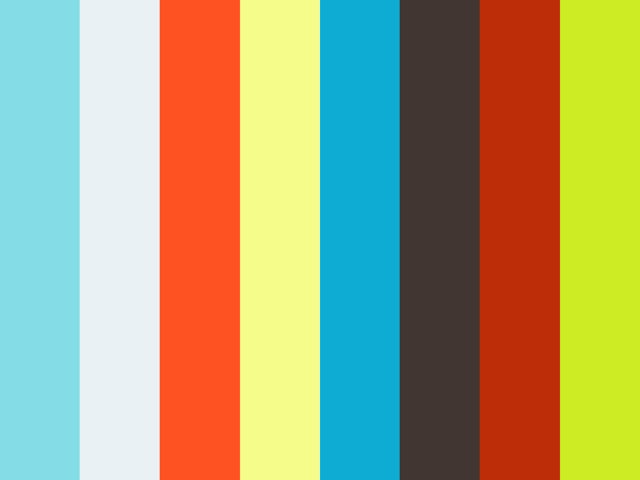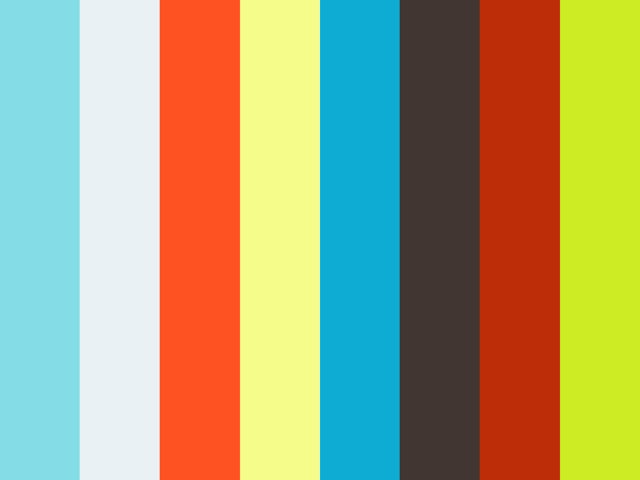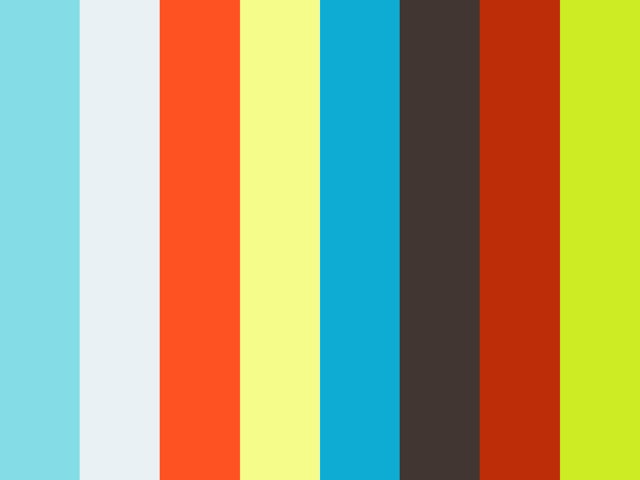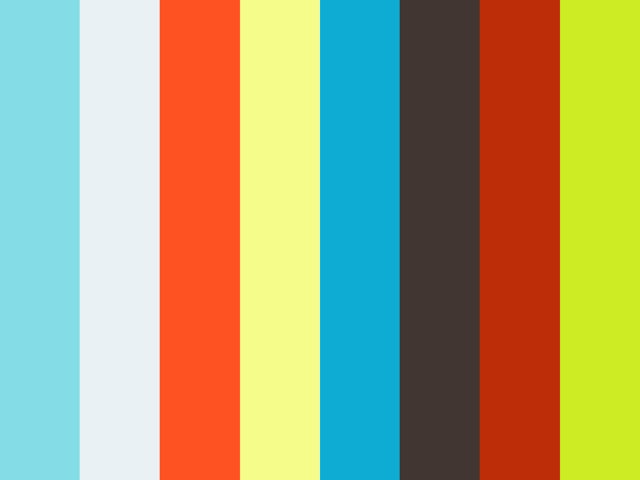Europe - La coopération sans le(s) droit(s) : le foisonnement des accords « injusticiables » avec les pays tiers - Plein Droit - n° 06/16
L’UE ont mis en place une coopération avec les pays non européens afin d’externaliser les frontières européennes
Depuis plus de deux décennies, l’Union européenne (UE) et ses États membres ont mis en place une étroite coopération avec les pays non européens – dits « tiers » – afin d’externaliser les frontières européennes [1]. L’instrument le plus emblématique de cette coopération est l’accord de réadmission, traité international par lequel chaque partie s’engage à réadmettre sur son territoire ses propres citoyens ainsi que, dans certains cas, les ressortissants d’autres pays ayant transité par son territoire. Cet engagement se traduit par la mise en place d’une procédure simplifiée et accélérée d’éloignement. Outre les nombreux accords bilatéraux conclus par les États membres, l’UE a elle-même signé de tels accords avec dix-sept pays [2]. Or, en facilitant la réadmission des étrangers, ces conventions neutralisent le droit au recours effectif et accroissent le risque de refoulement des demandeurs d’asile, qui peut intervenir directement vers le pays d’origine ou « en cascade », puisque les pays de réadmission concluent eux-mêmes des accords avec d’autres pays [3]. Ils sont en effet encouragés à mieux verrouiller leurs propres frontières, pour éviter de réadmettre des individus ayant transité par leur territoire. Ils instaurent ainsi des politiques restrictives des visas [4] et empêchent par tous moyens la sortie de leur propre territoire, notamment en « criminalisant » l’émigration, en totale méconnaissance du droit de chacun à quitter tout pays, y compris le sien.
Une tendance de longue date à l’injusticiabilité
Faiblement appliqués par certains pays [5], les accords de réadmission ne sont pas le seul outil utilisé par l’UE et les États membres pour renforcer la coopération. Depuis vingt ans, ils explorent en parallèle diverses modalités alternatives de coopération (clauses, partenariats, dialogues, programmes, agendas, etc.) [6]. Si le phénomène est loin d’être nouveau et a pu être analysé comme un processus d’« informalisation » de la coopération [7], c’est ici moins la forme que la valeur juridique des instruments qui importe. De plus en plus, les États membres et l’UE concluent en effet avec les pays tiers des « déclarations conjointes » et des « mémoires d’entente » qui, en droit international, s’apparentent plutôt à des « actes concertés non conventionnels ». Leur principale caractéristique est le refus des parties de contracter des obligations conventionnelles contraignantes. Ces accords « politiques » peuvent ainsi être conclus en dehors des procédures prévues pour l’adoption des traités internationaux et sont en principe dépourvus de justiciabilité, à moins d’être requalifiés par les juridictions compétentes.
Un autre type de coopération, dite « technique » ou « opérationnelle », intervient également en dehors du cadre classique des traités internationaux. Depuis 2006, l’agence européenne de surveillance des frontières Frontex a ainsi signé dix-huit « arrangements de travail » avec les autorités de pays tiers compétentes en matière d’immigration. Longtemps gardés secrets, ces textes ne sont pas considérés comme des accords internationaux, malgré leur impact sur les procédures de réadmission et sur les pratiques policières des pays tiers. Ils posent des questions de légitimité démocratique et de respect des droits fondamentaux [8], faute de garanties concrètes dans le règlement de l’agence.
Coopérer pour mieux déroger au(x) droit(s)
Des exemples plus récents confirment cette tendance à l’injusticiabilité. Deux séries d’accords a priori non conventionnels ont ainsi participé à fermer la route empruntée en 2015 par de nombreux réfugiés entre la Turquie et l’Europe de l’Ouest. La première série d’accords, moins connue, est intervenue pour verrouiller la route des Balkans, dans un contexte où l’Allemagne et l’Autriche avaient décidé de fermer leurs frontières. À la suite de plusieurs rencontres, le 18 février 2016, les directeurs des services de police autrichiens, slovènes, croates, serbes et macédoniens se sont réunis à Zagreb et ont convenu d’une « déclaration conjointe » sur la « gestion des flux migratoires » [9], comportant des mesures dérogatoires aux procédures prévues par la législation européenne, notamment en matière d’asile. Le point 6 de la déclaration conditionne l’admission des demandeurs d’asile au fait qu’ils arrivent de « pays ravagés par la guerre », à la preuve de leur nationalité et à la possession d’un formulaire d’enregistrement établi par les autorités grecques. Le point 7 mentionne la possibilité de refuser l’entrée à toute personne qui « donne de fausses informations [...] ou refuse de coopérer durant la procédure d’enregistrement ». Enfin, le point 9 prévoit que « lorsque les États autorisent l’entrée et le transit, toute autre restriction des pays de destination sera prise en compte (par exemple, les quotas journaliers actuels) ». Pourtant très critiquées, ces mesures dérogatoires ont été confirmées par une autre déclaration publiée le 24 février 2016 à l’issue d’une conférence intitulée « Managing Migration Together », qui a réuni à Vienne les ministres des affaires étrangères et de l’intérieur de Croatie, de Slovénie et d’Autriche d’une part, et de six pays des Balkans occidentaux d’autre part [10]. De vagues formules dans la déclaration assurent du respect du droit de l’UE et de la convention de Genève, sans expliciter comment les mesures dérogatoires prévues s’articulent concrètement avec les normes de protection des droits fondamentaux. Or, en pratique, la coopération non conventionnelle avec les pays des Balkans a bel et bien contribué à fermer la route turco-grecque, en particulier à travers les refoulements en chaîne et le blocage de dizaines de milliers de personnes en transit.
Plus connue est la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, qui a également freiné les arrivées en Grèce. S’inscrivant dans la lignée d’un plan d’action adopté en novembre 2015, le but officiel de la déclaration était de « mettre fin à la migration irrégulière de la Turquie vers l’UE ». Il existait déjà un accord de réadmission gréco-turc de 2004 ainsi qu’un accord de réadmission UE-Turquie de 2014 partiellement entré en vigueur [11]. Il s’agissait donc d’en favoriser la mise en œuvre concrète. La déclaration prévoit à cette fin le renvoi en Turquie de « tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 », y compris les demandeurs d’asile dont la demande est jugée « infondée ou irrecevable » [12], et la réinstallation d’un nombre égal de Syriens en Europe « pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques ». La Turquie s’engage à « prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de migration irrégulière, maritimes ou terrestres, ne s’ouvrent au départ de son territoire en direction de l’UE ». En contrepartie, sont prévus l’accélération de la libéralisation du régime des visas pour les citoyens turcs, le versement accéléré de 3 milliards d’euros au titre de la « facilité » en faveur des réfugiés en Turquie et la relance du processus d’adhésion à l’Union européenne.
La déclaration a essuyé de nombreuses critiques, notamment de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui s’est retiré des « hotspots » grecs [13], devenus de gigantesques centres de rétention à ciel ouvert. Le texte se présentant officiellement sous la forme d’un communiqué de presse, la question de sa valeur juridique s’est d’emblée posée [14], dans la mesure où il semblait malgré tout acter un accord international entre l’UE et la Turquie, sans respecter la procédure prévue par l’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’UE. Se posait également la question de la justiciabilité de la déclaration. Trois recours en annulation déposés par deux Pakistanais et un Afghan bloqués en Grèce ont tenté en vain de faire reconnaître sa qualité d’accord international pour en souligner l’illégalité au regard des conditions procédurales requises pour la conclusion d’un traité entre l’UE et un pays tiers. Les requêtes faisaient également valoir l’incompatibilité de l’accord avec de nombreux droits protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ainsi qu’avec l’obligation de non-refoulement, au vu des risques de renvoi vers la Turquie, mais aussi indirectement vers la Pakistan et l’Afghanistan [15]. Le 28 février 2017, le tribunal de l’UE s’est déclaré incompétent pour examiner les requêtes [16], estimant que « nonobstant les termes regrettablement ambigus de la déclaration UE-Turquie » [17], la déclaration émanait non du Conseil européen mais des chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’UE et qu’il ne s’agissait pas d’un accord international. L’appel formé contre l’ordonnance est à ce jour pendant devant la Cour de justice de l’UE (CJUE) [18].
La déclaration UE-Turquie, nouveau modèle de coopération ?
Malgré le tollé provoqué par cet accord et les doutes persistants sur sa légalité, la déclaration UE-Turquie a été présentée ultérieurement par la Commission européenne comme « une source d’inspiration pour la coopération avec d’autres pays tiers clés et [comme pouvant] mettre en lumière les grands leviers qu’il convient d’actionner [19] ». Les nouvelles formes de coopération suivies depuis juin 2016 semblent aller dans ce sens, notamment avec la mise en place d’un nouveau système de « pactes », dont l’objectif est de « parvenir à des augmentations spécifiques et quantifiables du nombre et du taux de retours et de réadmissions [20] ». La nature juridique des « pactes » pose question. Présentés sous la forme de cadres souples et protéiformes de coopération avec les pays tiers, ils peuvent avoir un impact direct sur les politiques de ces pays en matière de contrôles migratoires et donc sur les droits fondamentaux des étrangers qui en font l’objet. Pour autant, ce type d’instruments paraît hors de portée de tout contrôle juridictionnel.
Le même constat semble s’imposer concernant la déclaration conjointe UE-Afghanistan du 2 octobre 2016 intitulée « Joint Way Forward on Migration Issues between Afghanistan and the EU », qui marque « l’engagement partagé de l’UE et du gouvernement du Pakistan de renforcer la coopération en matière de gestion et de prévention de l’immigration irrégulière et de retour des migrants irréguliers [21] ». La déclaration précise, dans son introduction, qu’elle « n’a pas pour intention de créer des droits ou des obligations en droit international » [22]. La coopération non conventionnelle se poursuit également au niveau bilatéral, l’Italie ayant récemment conclu des « mémoires d’entente » de coopération policière avec la Gambie (juin 2015), le Soudan (août 2016) et la Libye (février 2017) [23]. Le Conseil européen, dans sa déclaration de Malte du 3 février 2017, s’est d’ailleurs félicité du dernier mémoire d’entente conclu avec la Libye et s’est dit « prêt à soutenir l’Italie dans sa mise en œuvre ».
Face au foisonnement de cet infra-droit légitimé par la « crise migratoire » [24], les exilés et leurs soutiens n’ont d’autre choix que d’attaquer les procédures qui résultent de cette coopération, afin d’en faire reconnaître l’illégalité au regard des normes de protection des droits de l’Homme [25]. La première manche vient d’être perdue devant l’Assemblée plénière du Conseil d’État grec, qui a confirmé, le 22 septembre 2017, la qualification de « pays tiers sûr » concernant la Turquie et a refusé de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE sur l’interprétation de cette notion. Il faudra patienter pour tirer le bilan des batailles juridiques qui ne sont pas parvenues, pour l’instant, à mettre un terme à l’enrôlement des pays tiers dans la fermeture arbitraire des frontières européennes.
Extrait du Plein droit n° 114
« L’Europe et ses voisins : marchandages migratoires »
(juin 2016, 10€)