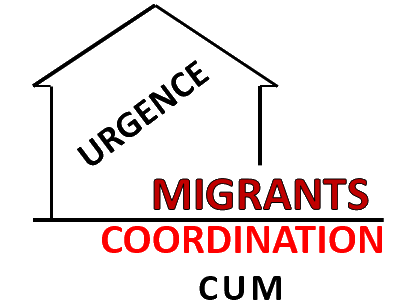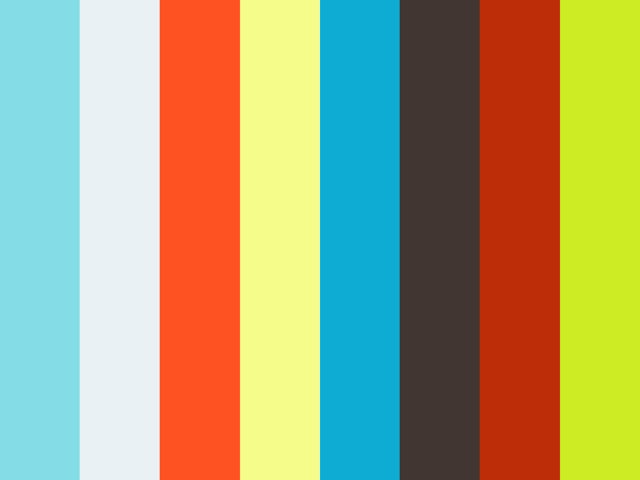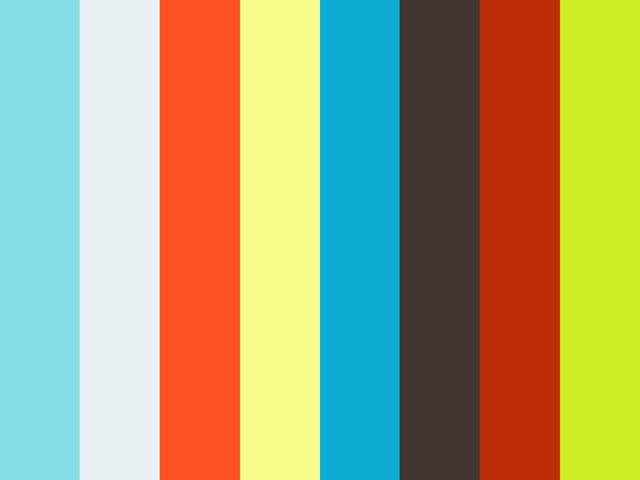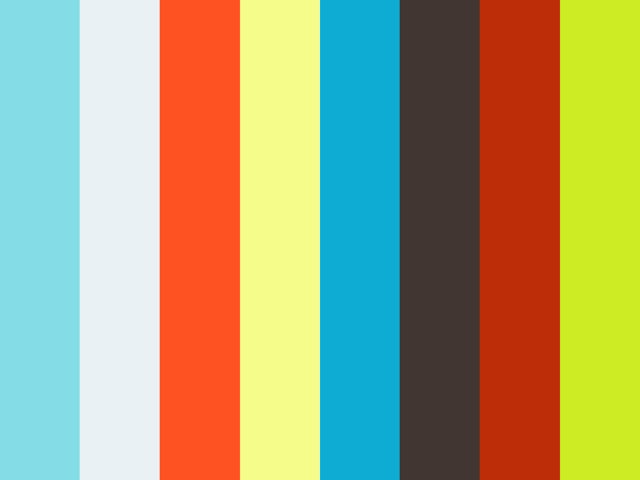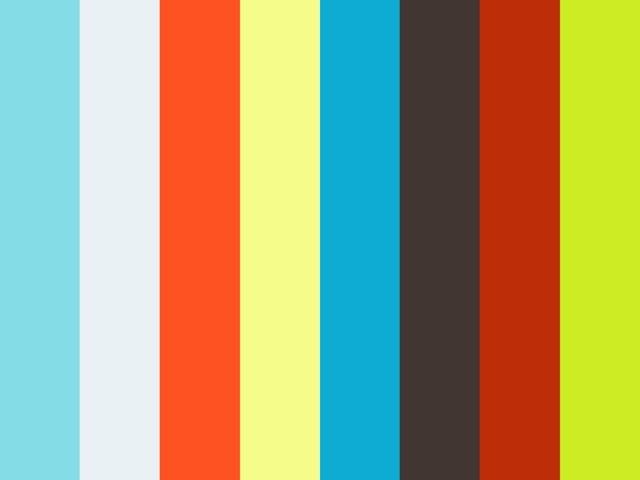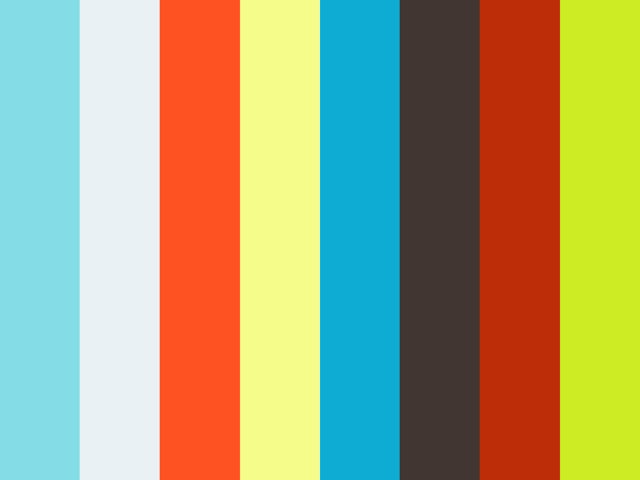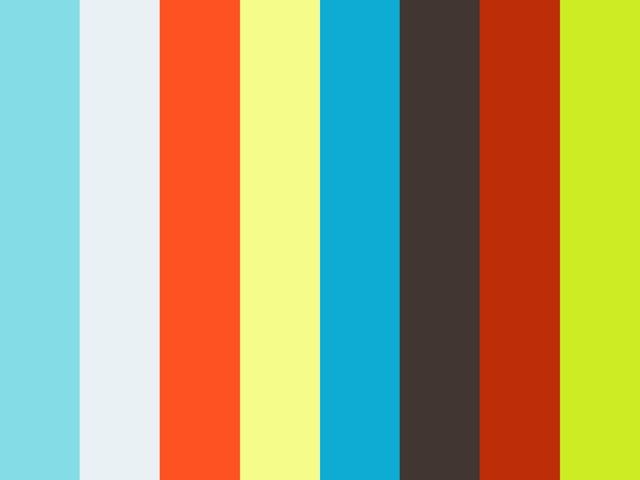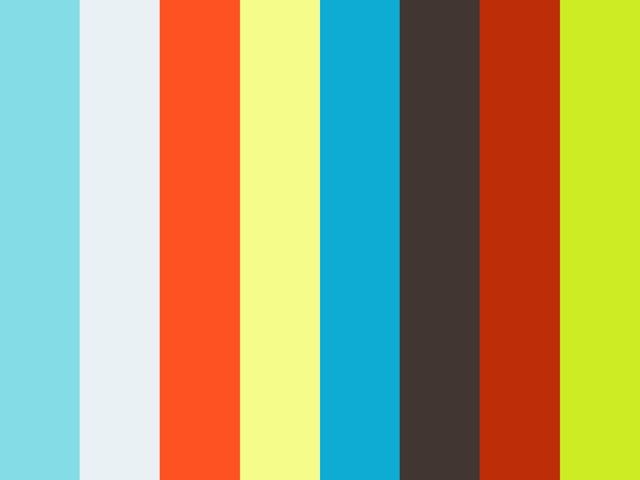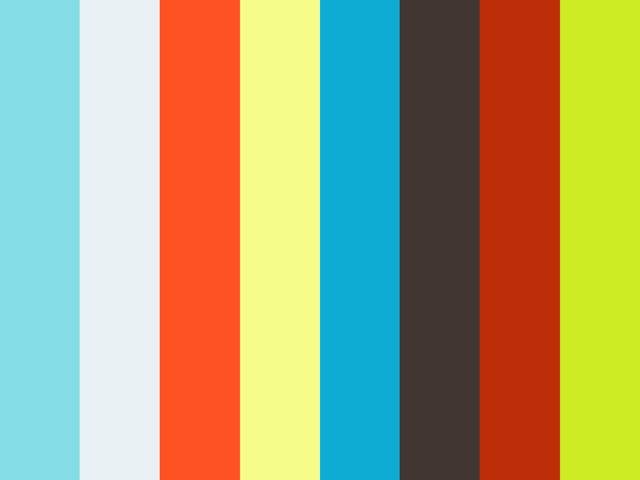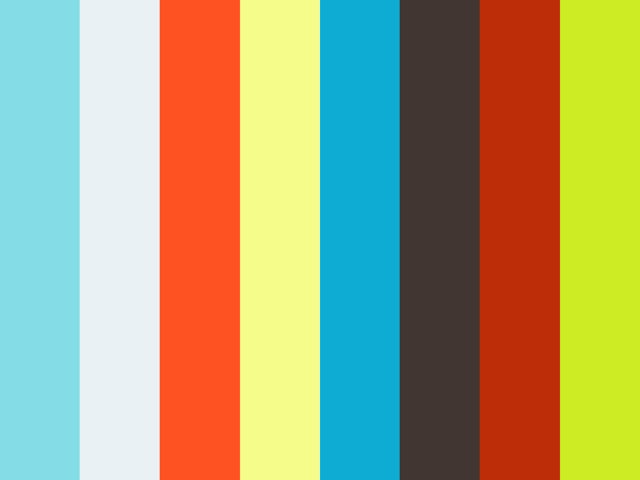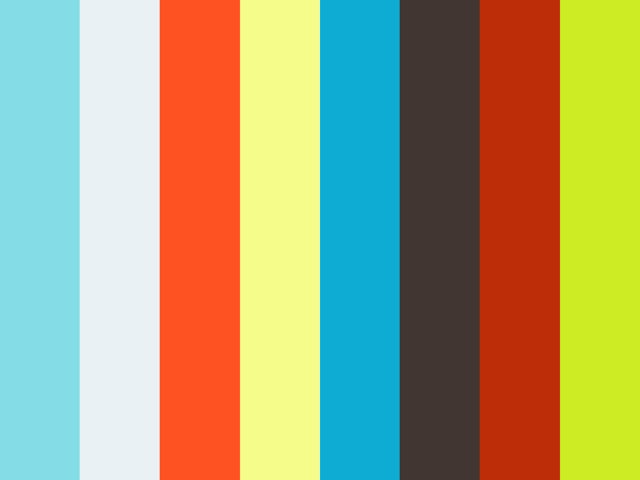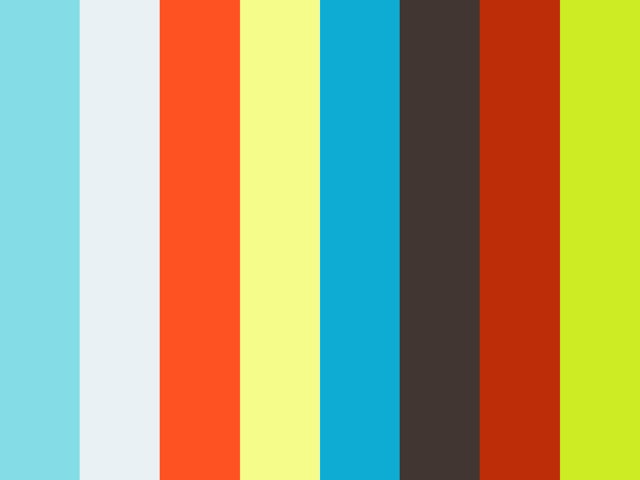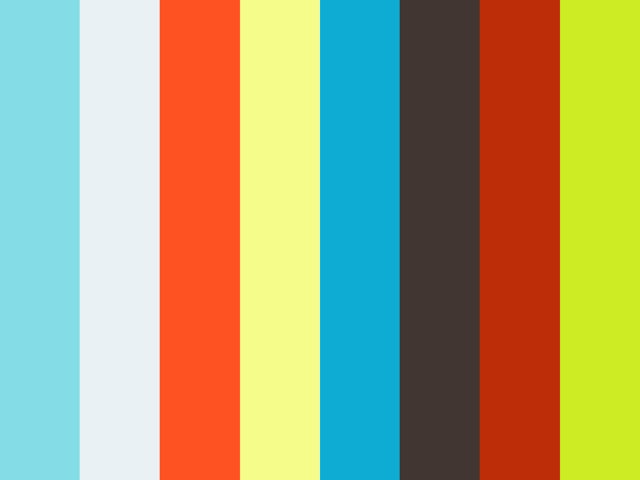1938 : le monde ferme ses portes aux réfugiés - GITSI - Article extrait du Plein droit n° 111
Danièle Lochak
Gisti, université Paris Nanterre
Des réfugiés qui fuient en masse le nazisme, des gouvernements qui leur barrent l’accès à leur territoire, des exilés contraints d’embarquer clandestinement sur des bateaux de fortune, une diplomatie prête à donner des gages aux pires dictatures et néanmoins impuissante, comme l’atteste l’échec prévisible de la conférence d’Évian en 1938 : les analogies sont décidément troublantes entre l’attitude des États à l’égard des Juifs dans les années 1930 et celle qu’ils adoptent aujourd’hui à l’égard des réfugiés.
Les États européens, obsédés par le « risque migratoire », mettent depuis de longues années toute leur énergie à tenir à distance les flux de migrants, demandeurs d’asile inclus, et à leur interdire l’accès à leurs territoires. Cette tendance a été poussée à son paroxysme au moment de la « crise migratoire » de 2015, face à l’afflux de réfugiés venus de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan ou d’Érythrée. Au point que plusieurs observateurs n’ont pu s’empêcher de faire le parallèle avec l’attitude qui fut celle des États, dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, à l’égard des Juifs fuyant le nazisme [1].
Ce parallèle non seulement n’a rien de scabreux, mais il s’impose. Il n’a rien de scabreux car si les Juifs, à l’époque, sont persécutés, spoliés, humiliés, pourchassés, physiquement agressés, personne ne peut alors anticiper la « solution finale ». Il s’impose tant les analogies sont frappantes : la fermeture de plus en plus hermétique des frontières à mesure que la persécution s’aggrave et que les flux d’exilés augmentent ; des réfugiés contraints à embarquer clandestinement sur des bateaux de fortune avec l’espoir, souvent déçu, qu’on les laissera débarquer quelque part ; en guise de justification, la situation économique et le chômage, d’un côté, l’état de l’opinion dont il ne faut pas attiser les tendances xénophobes et antisémites, de l’autre ; le fantasme, hier, de la « cinquième colonne » – agitateurs communistes, espions nazis –, aujourd’hui de la menace terroriste ; et finalement une diplomatie qui n’hésite pas à pactiser avec les pires dictatures, hier pour tenter de sauver la paix (on sait ce qu’il en est advenu), aujourd’hui pour tenter d’endiguer les flux de réfugiés.
L’évocation du passé donne, hélas, le sentiment que l’histoire bégaie : car la Realpolitik qui prenait hier le pas sur les préoccupations humanitaires continue aujourd’hui à dicter l’attitude des États, alors même qu’ils ont collectivement décidé d’accorder au droit d’asile une place éminente parmi les droits de l’Homme et se sont engagés à le respecter.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la communauté internationale, inquiète des risques de déstabilisation engendrés par les masses de réfugiés qui, par centaines de milliers, fuient les guerres civiles, les dictatures, les persécutions, décide de se saisir du problème.
Mais l’action diplomatique en faveur des réfugiés reste subordonnée à la défense par les États de leurs intérêts propres et de leurs prérogatives souveraines. Entre 1922 et 1928, une multitude d’« arrangements » sont passés sous l’égide de la Société des Nations, visant à accorder un minimum de protection aux réfugiés. C’est notamment le fameux « passeport Nansen » qui leur confère, à eux qui ne sont plus reconnus ni protégés par leur pays d’origine, un minimum d’existence juridique. Mais la portée de ces textes, applicables au départ aux réfugiés russes, puis aux Arméniens, puis aux Assyro-Chaldéens, est très limitée, tant par la faiblesse des garanties qu’ils confèrent que par leur absence de caractère obligatoire. Avec l’aggravation de la situation économique consécutive à la crise de 1929, les États n’hésitent pas à refouler ou expulser les réfugiés, considérés comme un fardeau. À l’approche de la guerre, viendront s’ajouter à ces considérations économiques des considérations de police et de sécurité.
Des arrangements sans contrainte
C’est dans ce contexte que les États vont être confrontés à la question des réfugiés provenant d’Allemagne puis, après l’Anschluss, d’Autriche. La diplomatie s’active timidement : un « arrangement provisoire intergouvernemental concernant le statut des réfugiés venant d’Allemagne » est signé le 4 juillet 1936, dont les dispositions sont reprises dans la convention du 10 février 1938 : les États s’engagent à délivrer aux réfugiés un titre de voyage ou un document tenant lieu de passeport ; lorsqu’ils les ont autorisés à séjourner, ils ne peuvent les expulser ou les refouler qu’en cas de risque pour la sécurité nationale ou l’ordre public, et, en aucun cas, vers l’Allemagne sauf « s’ils ont de mauvaise foi refusé de prendre les dispositions nécessaires pour se rendre dans un autre territoire ». Mais la convention n’est signée que par sept pays : la Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Espagne, la France, la Norvège et les Pays-Bas, et elle n’aura guère le temps, de toute façon, de produire des effets avant le déclenchement de la guerre.
Ayant juridiquement toute latitude pour agir à leur guise, les États n’ont aucun scrupule à fermer leurs frontières. Les États-Unis s’en tiennent à la politique adoptée depuis l’Immigration Act de 1924 et à un quota annuel de 27 370 immigrants pour l’Allemagne et l’Autriche. Après l’Anschluss, le ministre de l’intérieur britannique, s’adressant à la Chambre de communes, affirme que le pays maintient sa tradition d’asile, mais qu’il faut « éviter de donner l’impression que la porte est ouverte aux immigrants de toutes sortes. Car alors de prétendus émigrants se présenteraient dans les ports en si grand nombre qu’il serait impossible de les admettre tous ; les services d’immigration auraient de grandes difficultés à décider qui devrait être admis et d’inutiles épreuves seraient imposées à ceux qui effectueraient un infructueux périple à travers l’Europe [2] ». Pour les Britanniques, au demeurant, la question centrale reste celle de la Palestine : depuis l’arrivée de Hitler au pouvoir, l’immigration est passée de 9 500 personnes par an à 30 000 en 1933 et à près de 62 000 en 1935. Alors que ce territoire apparaît comme le seul lieu de refuge potentiel pour les Juifs, la Grande-Bretagne, confrontée à l’hostilité des Arabes, remet en question son engagement en faveur de l’établissement d’un Foyer national juif : le Livre blanc du printemps 1939 limite le quota annuel d’immigrants vers la Palestine à 10 000 personnes par an pour les cinq années suivantes. Des navires de la Royal Navy patrouillent pour empêcher les réfugiés d’accoster. S’ils n’ont pas de certificat ils sont refoulés ou bien internés à Chypre, sur l’île Maurice ou en Palestine même.
En France, en 1933, les premiers réfugiés passent facilement la frontière. Mais, très vite, les pouvoirs publics s’inquiètent de cet afflux des exilés et, dès la fin de l’année, l’attitude change : nombre de candidats à l’entrée sont refoulés et ceux qui, ayant réussi à entrer, ne sont pas en règle sont expulsés. L’arrivée au pouvoir du Front populaire marque une accalmie temporaire, mais la situation des réfugiés, considérés comme une menace pour la sécurité, voire comme une porte d’entrée pour les espions et les agitateurs, se dégrade à nouveau sous le gouvernement Daladier. En aucun cas, dit le ministre de l’intérieur de l’époque ,« la France ne saurait consentir à ouvrir ses frontières inconditionnellement et sans limitation à des individus par le fait seul qu’ils se prévaudraient de leur qualité de réfugiés. En effet l’état de saturation auquel nous sommes arrivés en matière d’immigration étrangère ne nous permet plus d’adopter une politique aussi libérale [3] ».
La Suisse entrouvre sa porte aux réfugiés allemands en 1933 – mais ne peuvent se revendiquer de cette qualité que les personnes menacées pour leurs activités politiques. Une directive du Département fédéral de justice et police dit très explicitement que seuls les « hauts fonctionnaires, les dirigeants des partis de gauche et les écrivains célèbres » doivent être considérés comme réfugiés [4]. Les Juifs, eux, sont considérés comme de simples étrangers en transit et se voient reconnaître au mieux un droit de résidence temporaire, sans possibilité de travailler. Après l’Anschluss, le gouvernement décide la fermeture des frontières à tous ceux qui ne sont pas formellement habilités à entrer et l’expulsion de ceux qui sont en situation irrégulière. Pour faciliter le travail des autorités suisses amenées à faire le tri parmi les ressortissants du Reich, une négociation s’engage avec les autorités nazies pour que soit apposé un cachet spécial sur les passeports des Juifs – un grand J rouge de trois centimètres de hauteur – qui permet de repérer ceux qui doivent demander une autorisation spéciale pour entrer dans le pays [5].
« Un seul serait déjà trop »
Il n’est guère étonnant, dans ces conditions, que la conférence d’Évian, réunie en juillet 1938 pour chercher des solutions concrètes au problème des réfugiés juifs allemands et autrichiens, se solde par un échec [6]. Face à la détérioration de la situation et à la pression exercée par une partie de l’opinion publique, mais désireux aussi d’éviter un brusque afflux de réfugiés aux États-Unis, Roosevelt a en effet pris l’initiative de réunir une conférence internationale qui se tient à Évian du 6 au 15 juillet.
Les représentants des 32 États présents, tout en affirmant leur implication dans le règlement de la question des réfugiés, se retranchent derrière des considérations économiques et politiques pour justifier la fermeture de leurs pays à l’immigration et le refus d’accueillir des réfugiés juifs.
![]()
Dessin paru dans le New York Times du 3 juillet 1938, après la conférence d’Évian.
Les pays d’Europe occidentale se disent tous « saturés » : la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Danemark, la Suède, la Suisse se déclarent les uns après les autres dans l’incapacité d’accueillir des réfugiés et n’envisagent d’accorder que des visas de transit. Le représentant de l’Australie déclare sans complexe que : « N’ayant aucun réel problème racial en Australie, nous ne sommes pas désireux d’en importer en encourageant une large immigration étrangère. » Et le délégué canadien, interrogé sur le nombre de réfugiés que son gouvernement pourrait envisager d’accueillir, répond : « Un seul serait déjà trop. »
Même les pays d’Amérique du Sud, terres traditionnelles d’immigration, font part de leurs réserves : les uns invoquent la crise économique, les autres craignent de déplaire à l’Allemagne à laquelle les lient des accords commerciaux. La Colombie dit pouvoir accepter des travailleurs agricoles, l’Uruguay également, à condition qu’ils possèdent quelques ressources. Seule la République dominicaine de Trujillo offre d’accueillir 100 000 réfugiés juifs autrichiens et allemands, pour des raisons qui ont peu à voir avec la compassion humanitaire : c’est une occasion de « blanchir » une population jugée trop noire ; et cette offre généreuse vise aussi à redresser l’image d’un pays ternie par le massacre, en octobre 1937, à l’instigation des autorités, de milliers de Haïtiens travaillant dans les plantations.
La conférence d’Évian se conclut donc sur un constat d’impuissance de la communauté internationale. Ce qui permet au journal allemand Reichswart d’ironiser : « Juifs à céder à bas prix – Qui en veut ? Personne !? » Hitler en effet peut triompher : personne ne veut accueillir ses Juifs.
Impuissante, cette diplomatie est également sans scrupule, prête à toutes les concessions face à Hitler si tel est le prix à payer pour sauver la paix. Les orateurs à la tribune se bornent à exprimer le vœu d’« obtenir la collaboration du pays d’origine », pays jamais nommé et jamais stigmatisé pour ses agissements ; à aucun moment il n’est fait ouvertement mention du fait que ces réfugiés sont juifs, pour ne pas fournir un argument supplémentaire à la campagne fasciste contre les démocraties « enjuivées ». Dans la résolution finale, purgée de toute appréciation morale sur les persécutions, les termes « réfugiés politiques » sont remplacés par « immigrants involontaires » pour éviter de froisser le Troisième Reich.
Le seul résultat concret de la conférence est la création d’un Comité intergouvernemental d’aide aux réfugiés allemands et autrichiens qui aura pour mission d’entreprendre « des négociations en vue d’améliorer l’état des choses actuel et de substituer à un exode une émigration ordonnée ». Aux yeux des pays occidentaux, en effet, de la même façon que la voie de la paix doit être recherchée en discutant avec Hitler, le problème des réfugiés ne peut être résolu qu’en accord avec les nazis.
Les « petits bateaux de la mort »
Visas refusés, frontières closes : les réfugiés sont acculés, en désespoir de cause, à prendre la mer, le plus souvent clandestinement. À la veille de la guerre, des dizaines, des centaines de bateaux, parfois des paquebots de ligne, souvent des bâtiments de fortune ou de contrebande qui ont pris leurs passagers en charge frauduleusement, naviguent sur les océans à la recherche d’un port où ils seront autorisés à débarquer : le Cairo part le 22 avril 1939 de Hambourg pour Alexandrie ; l’Usaramo pour Shanghai ; l’Orbita pour le Panama en juin 1939 ; l’Orinoco, vers Cuba [7]
D’autres restent bloqués pendant des semaines ou des mois dans les ports roumains de la mer Noire ou sur le Danube. D’autres encore errent en Méditerranée, avec l’espoir vain de pouvoir accoster en Palestine. La presse française se fait l’écho de ces « vaisseaux fantômes » voguant de port en port sans qu’on laisse leurs passagers débarquer, ne serait-ce qu’en transit, transportant par milliers « ces hommes, ces femmes, ces enfants dont personne ne veut », qui sillonnent les mers en se heurtant à l’inhospitalité des côtes [8].
Même ceux qui ont des papiers d’immigration en règle ne sont pas assurés d’être admis, comme le montre l’histoire cruelle du Saint-Louis. Ce paquebot transatlantique quitte Hambourg le 13 mai 1939 en direction de La Havane. Ses 937 passagers, presque tous des Juifs fuyant le Troisième Reich, sont en possession de certificats de débarquement émis par le directeur général de l’immigration de Cuba. Mais, dans l’intervalle, le président cubain a invalidé ces certificats. On interdit donc aux passagers de débarquer. Le bateau repart, et lorsqu’il passe le long des côtes de Floride une demande est adressée au président des États-Unis afin qu’il leur accorde l’asile – elle ne reçoit pas de réponse. Le 6 juin 1939, le Saint Louis reprend sa route vers l’Europe. In extremis, avant que le bateau ne soit contraint de revenir en Allemagne, le Jewish Joint Commitee réussit à négocier avec les gouvernements européens une répartition des passagers entre la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas qui n’acceptèrent de les accueillir qu’à condition qu’il ne s’agisse que d’un transit dans l’attente d’une émigration définitive vers une autre destination. Temporairement sauvés, une majorité d’entre eux connaîtra le sort réservé aux Juifs dans les pays occupés par l’Allemagne.
Les embarquements clandestins se poursuivent une fois la guerre déclenchée, les réfugiés prenant des risques croissants pour tenter de rejoindre clandestinement la Palestine depuis les ports de la mer Noire, à travers le Bosphore, les Dardanelles et la mer Égée. Un gigantesque marché noir s’organise, avec la bénédiction des nazis qui, avant la programmation de la « solution finale », y voient une façon de débarrasser l’Europe de ses Juifs. Beaucoup de ces « bateaux cercueils », comme on les a appelés, font naufrage, d’autres sont victimes des mines ou des sous-marins allemands, et les épidémies déciment ceux qui ont réussi à survivre [9]. Lorsque, ayant surmonté tous ces obstacles, y compris percé le blocus britannique, ils arrivent à Haïfa ou Tel-Aviv, ils sont, dans le meilleur des cas, arrêtés et incarcérés, sinon refoulés et contraints de reprendre la route vers la Bulgarie ou la Roumanie.
On voit ici, comme un clin d’œil de l’histoire, la place géographiquement stratégique, déjà à l’époque, de la Turquie, qui contrôle la route empruntée par les réfugiés obligés de traverser les détroits du Bosphore et des Dardanelles. La Turquie interdit l’accès à son territoire aux réfugiés qui ne détiennent pas de visa pour la Palestine et, sous la pression de la Grande-Bretagne, ne laisse pas les bateaux faire escale dans ses ports, ce qui provoquera la catastrophe du Struma (voir encadré). Décidément, on a parfois l’impression que l’histoire bégaie.
Le StrumaLe 12 décembre 1941, 767 réfugiés juifs originaires de Bucovine et de Bessarabie – où sévissent les Einsatzgruppen – embarquent sur le Struma, un navire bulgare vétuste, prévu pour une centaine de passagers. Le navire part du port roumain de Constanza, sur la mer Noire, en direction d’Istanbul où les réfugiés espèrent pouvoir déposer des demandes de visa pour la Palestine. Le 16 décembre le bateau arrive dans un port turc au nord du Bosphore, mais la Grande-Bretagne fait pression sur la Turquie pour qu’elle l’empêche de poursuivre sa route. Le Struma reste ainsi bloqué 70 jours, pendant l’hiver 1941-1942, sur le Bosphore. Les réfugiés souffrent de la faim, de l’entassement. Ils finissent par être ravitaillés grâce aux dons des associations juives et avec l’aide de la Croix-Rouge. Les autorités turques décident de le refouler vers la mer Noire et le 23 février 1942 le bateau reçoit l’ordre d’appareiller : ce sont finalement les garde-côtes turcs qui doivent remorquer le Struma, hors d’état de naviguer. Quelques heures plus tard, il est touché par erreur par une torpille soviétique et coule rapidement. Il n’y aura qu’un seul survivant.) |
Les exilésLe roman de Erich Maria Remarque, Les exilés, fournit un témoignage de la situation des apatrides, sans-papiers, dans les années précédant la guerre. Il relate comment les douaniers leur font passer la frontière la nuit, avant que d’autres douaniers ne la leur fassent repasser dans l’autre sens, comment ils obtiennent difficilement des permis de séjour de cinq ou dix jours et risquent à tout moment d’être emprisonnés ou expulsés s’ils ne se déclarent pas à la police ou s’ils dépassent la durée de leur permis.
Un des exilés originaires d’Allemagne a cet échange avec un juge suisse bienveillant :
Extrait du Plein droit n° 111
|