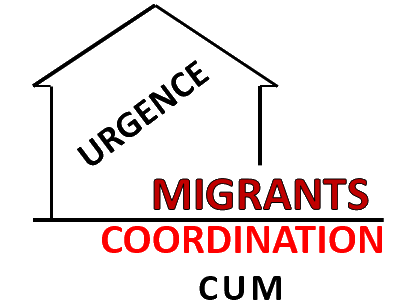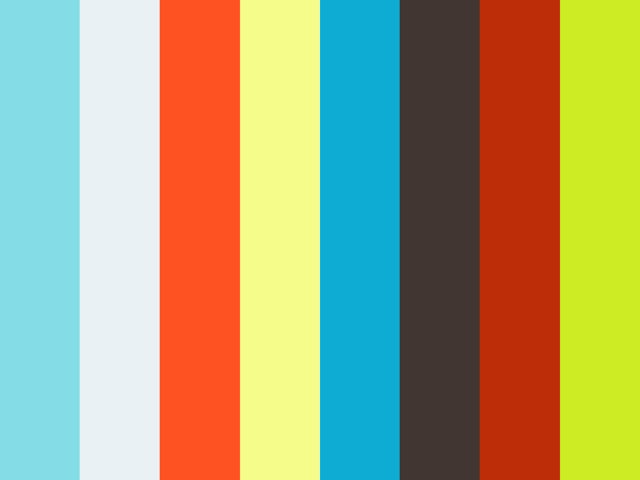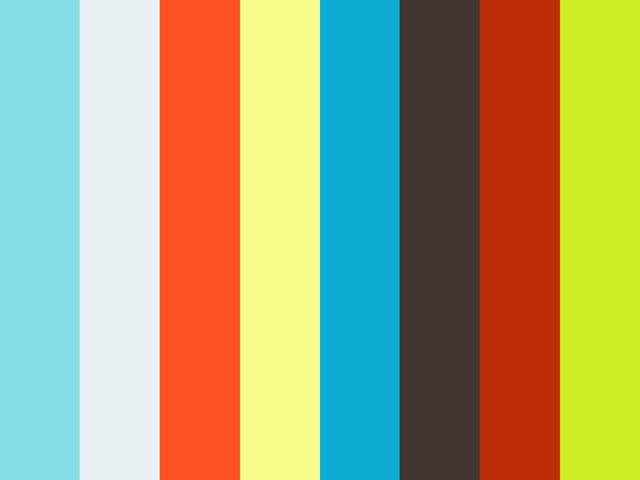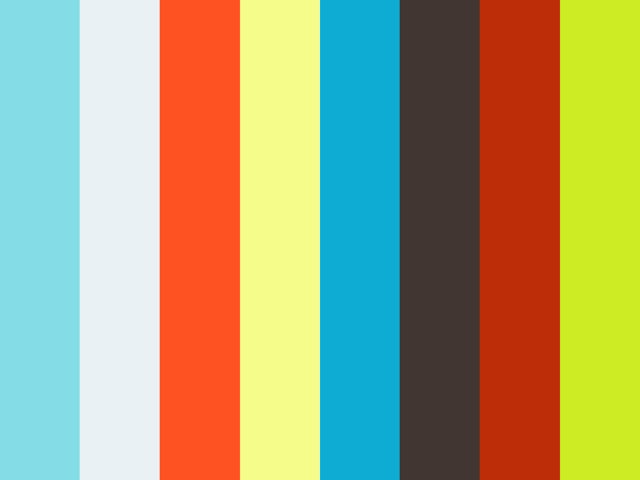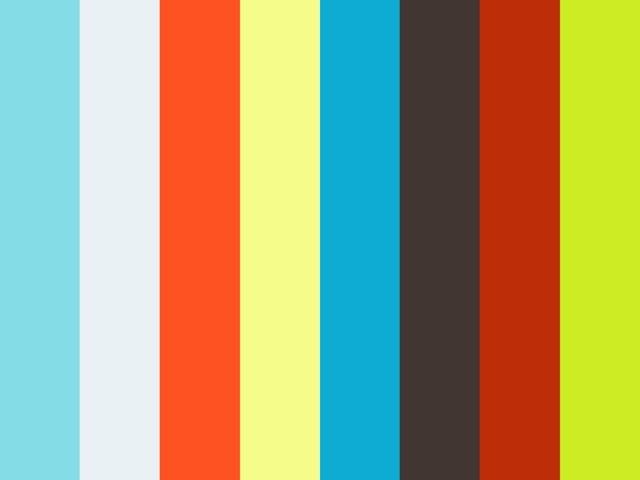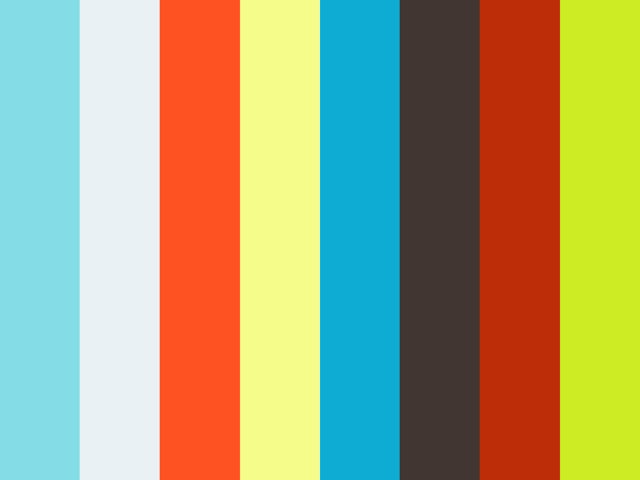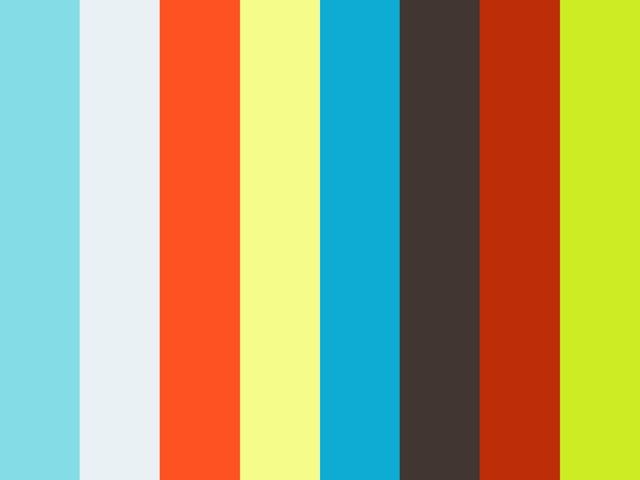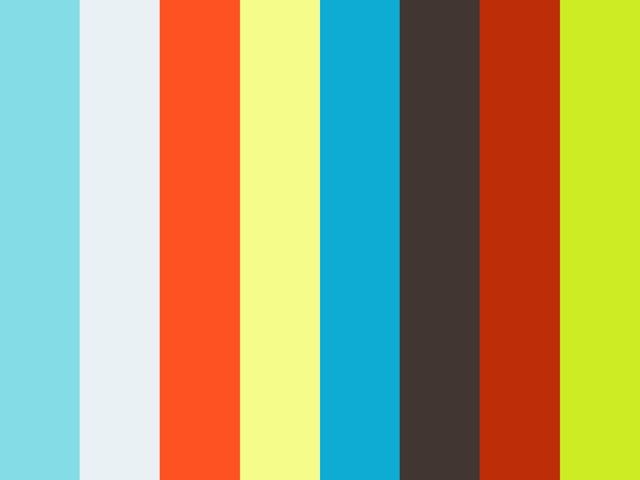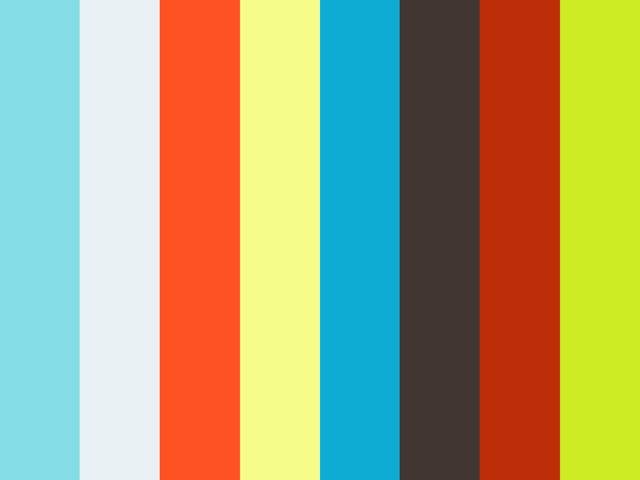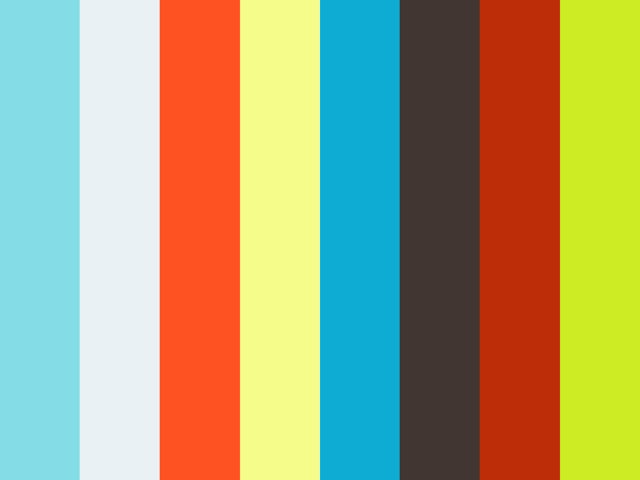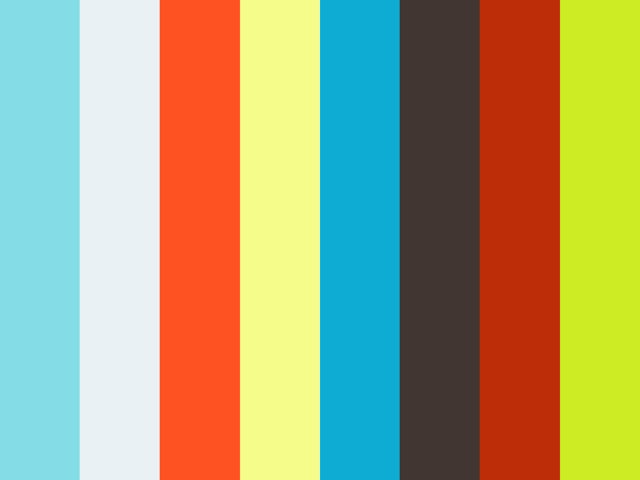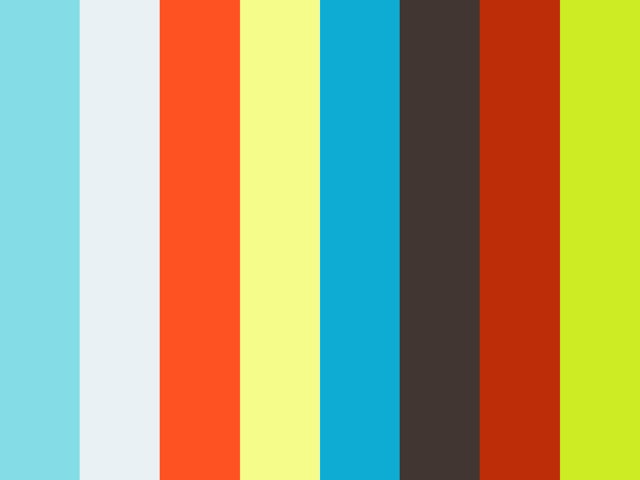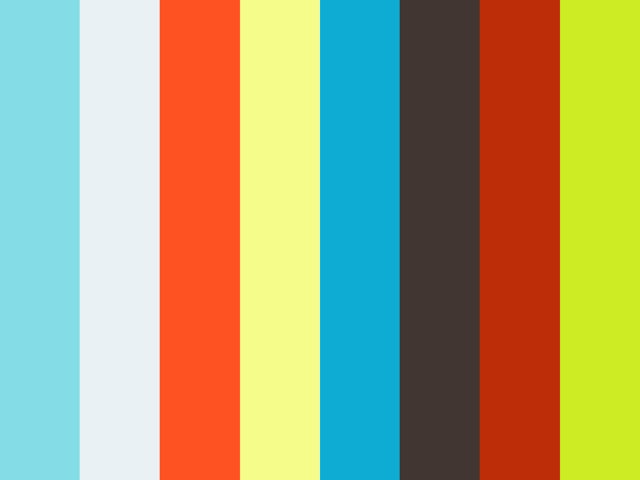GITSI : Externaliser la demande d’asile
Claire Rodier
Gisti
Hier comme aujourd’hui, l’objectif des États membres de l’UE en matière d’asile consiste à mettre à distance les demandeurs d’asile. Pour ne pas avoir à appliquer la convention de Genève sur les réfugiés dont ils sont signataires ou la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui garantit un principe de non-refoulement, quelle meilleure méthode que de faire en sorte que les potentiels réfugiés n’accèdent pas à leurs frontières ? En faisant peser sur des pays non européens – et parfois non démocratiques – la responsabilité de la prise en charge des candidats à l’asile, l’Europe se protège des « indésirables ».
L’annonce est sortie de la réunion du conseil des ministres de l’intérieur de l’Union européenne (UE) le 12 mars 2015 : pour faire face au nombre toujours croissant de migrants en partance pour l’Europe depuis les zones de conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les ministres des vingt-huit États membres envisagent la mise en place de centres de traitement des demandes d’asile dans des pays tiers. Selon les propos d’un diplomate recueillis le lendemain par l’AFP, la prise en charge des demandeurs d’asile pourrait être confiée au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). « Une fois la demande admise, l’UE ferait venir le réfugié sur son territoire. »
Un peu effacé par la terrible actualité du mois d’avril, le projet de camps externalisés pour traiter les demandes d’asile hors d’Europe est en effet réapparu au détour de l’« agenda » présenté par la Commission européenne le 13 mai 2015 pour en finir avec les naufrages à répétition de boat people [1]. Parmi les propositions, un important volet est consacré à la coopération avec les pays tiers pour lutter contre l’immigration irrégulière et prendre en charge les migrants avant qu’ils n’atteignent les rives européennes. On y trouve l’annonce de l’ouverture, avant la fin de l’année, d’un « centre pilote multifonctions » (pilot multi-purpose centre) au Niger : en partenariat avec l’OIM, le HCR et le gouvernement nigérien, il y sera offert de l’information, une protection locale et des possibilités de réinstallation pour les personnes qui en auront besoin. Le centre nigérien ne serait qu’un début : la Commission prévoit que de tels centres, installés dans les pays d’origine et de transit, pourraient aider à éclairer les candidats à la migration sur la réalité du parcours qui les attend, et offrir des options de retour volontaire aux personnes en situation irrégulière.
Des dictatures partenaires
Ce centre multifonctions est une étape concrète du processus de Khartoum, « dialogue euro-africain » initié en novembre 2014, qu’on appelle aussi « initiative pour la route migratoire UE-Corne de l’Afrique ». Ce dialogue associe les 28 pays de l’Union, Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Sud Soudan, le Soudan, la Tunisie, rejoints par la Norvège et la Suisse, pour affronter de manière conjointe le phénomène migratoire sur la route UE-Corne de l’Afrique. Il y est question de « mettre en place une coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination afin de lutter contre l’immigration irrégulière et contre les filières criminelles, notamment par le biais d’initiatives en matière d’assistance technique, de formations et d’échange d’informations et de bonnes pratiques », d’aider les pays participant au processus à créer et à gérer des centres d’accueil, et d’offrir un accès aux procédures d’asile « en conformité avec le droit international ». La présence, dans la liste des partenaires impliqués, de régimes dictatoriaux grands « pourvoyeurs » de réfugiés laisse perplexe. Même si Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen chargé de ce dossier, affirme que « nous ne devons pas être naïfs. Le fait que nous coopérions avec des régimes dictatoriaux ne signifie pas que nous les légitimions. Mais nous devons coopérer là où nous avons décidé de lutter contre la contrebande et la traite des êtres humains [2] », on ne peut s’empêcher de penser que, plutôt que de protéger les persécutés, l’Europe cherche avant tout à s’en protéger.
Le processus de Khartoum s’inscrit dans la continuité de la politique d’externalisation de l’asile menée par l’Europe depuis le début des années 2000. Hier comme aujourd’hui, l’objectif est le même : il s’agit pour les États membres de l’UE de mettre à distance les demandeurs d’asile et, du même coup, d’ignorer leurs obligations en matière de protection internationale. Tous les pays membres sont signataires de la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, qui les oblige à examiner la demande de protection de toute personne qui se trouve sur leur territoire ou se présente à leurs frontières. Cette convention pose aussi un principe de non-refoulement, qui interdit d’expulser ou de refouler un réfugié (ou une personne qui pourrait se voir reconnaître cette qualité) sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Le principe de non-refoulement est également garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour contourner ces obligations, quelle meilleure méthode que de s’arranger pour que les potentiels réfugiés n’accèdent pas aux frontières des pays où ils pourraient solliciter leur admission au titre de l’asile ?
C’est ce à quoi s’emploie l’UE en faisant d’abord croire qu’elle est « envahie » par les demandeurs d’asile dont un bon nombre seraient des « fraudeurs ». Quelque fantasmatique qu’il soit – aujourd’hui, sur les 16,7 millions de personnes réfugiées dans le monde, 80 % sont accueillies dans des pays en voie de développement, quand l’Europe, les États-Unis, le Canada et l’Australie réunis n’en abritent que 15 % – ce tableau menaçant a permis de justifier deux types de riposte : d’une part, le renforcement du contrôle des frontières pour dissuader et combattre cette « immigration clandestine ». Bien que le HCR rappelle régulièrement que les flux migratoires en route vers l’Europe sont « mixtes » – c’est-à-dire composés de candidats à l’immigration et de personnes qui fuient les persécutions –, et que lutter contre les uns conduit nécessairement à priver les autres de leur droit à recevoir une protection, les dispositifs de surveillance comme ceux qui sont mis en place par l’agence Frontex depuis 2004 font fi de cette réalité. D’autre part, la recherche de solutions pour faire peser sur des pays non européens la responsabilité de la prise en charge des candidats à l’asile que l’Europe ne veut pas accueillir. C’est dans le cadre de cette « dimension externe » de la politique d’asile, qui a connu bien d’autres développements [3], qu’ont émergé sous diverses formes, depuis une quinzaine d’années, des propositions visant à les installer et à faire traiter leurs demandes dans des camps hors du territoire européen.
« Transit processing centers »
En mars 2003, l’idée est venue du Royaume-Uni, qui proposait à ses partenaires de l’UE une « approche internationale » du traitement de l’asile [4]. Se référant explicitement à la Pacific Solution australienne (voir encadré), elle partait du postulat selon lequel le système d’asile était en crise, en raison de l’utilisation abusive du canal de l’asile par de « faux » réfugiés qui cherchaient à contourner les règles de l’immigration économique, menaçant de ce fait la viabilité du régime de protection internationale. La proposition britannique prévoyait la mise en place de centres de transit et de traitement (transit processing centers, TPC) dans les régions traversées par les demandeurs d’asile en route vers l’Europe, où ces derniers seraient renvoyés dès leur tentative de passage d’une frontière européenne, afin qu’il soit procédé à l’examen de leur demande. Dans le projet, il était prévu d’envoyer ces demandeurs d’asile dans un TPC en Albanie, en Bulgarie ou en Roumanie (ces deux derniers pays n’étant à l’époque pas encore membres de l’UE). Ceux qui seraient reconnus réfugiés seraient réinstallés dans un des pays de l’UE, les autres étant renvoyés dans leur pays d’origine ou dans des pays relevant de la zone de protection de leur région d’origine (Turquie, Iran, Kurdistan irakien, Somalie ou Maroc). Le projet sera finalement écarté au sommet de Thessalonique de juin 2003, faute de recueillir l’assentiment de certains États membres. Exit les camps ? Pas sûr. Dans les conclusions du sommet, le Conseil européen invitait la Commission « à explorer tous les paramètres permettant d’assurer que l’entrée dans l’UE des personnes qui ont besoin d’une protection internationale se fasse d’une manière plus ordonnée et mieux gérée, et à examiner comment les régions d’origine pourraient mieux assurer la protection de ces personnes », et notait « qu’un certain nombre d’États membres envisagent d’étudier des moyens d’améliorer la protection des réfugiés dans leur région d’origine, en liaison avec le HCR [5] ».
De fait, le HCR, alors engagé dans une réflexion sur les nouvelles formes que pourrait prendre la protection internationale compte tenu « du nombre croissant d’abus des procédures d’asile », proposait, dans le cadre d’un programme nommé « Convention plus », la détention des « faux réfugiés » dans des centres fermés, éventuellement sur le territoire de certains des futurs États membres, ceux qui allaient entrer dans l’UE en 2004 et qui forment la frontière extérieure de l’Union à l’est. Certes, les projets du HCR ne visaient que la demande d’asile dite « abusive », celle dont il a été décrété qu’elle était « manifestement infondée » selon la formule consacrée, alors que la proposition britannique concernait le transfert de tous les demandeurs d’asile dans des camps externalisés. Il reste qu’en validant, d’une part, le principe de l’asile ailleurs, d’autre part, le recours à la détention des demandeurs d’asile, le HCR prenait le risque de légitimer le camp externalisé comme outil de gestion de l’asile par l’Europe [6].
De son côté, la Commission européenne, pour répondre à la « crise du système d’asile » en Europe, invitait en mars 2003, dans la foulée de la proposition britannique, à rechercher de nouvelles voies, parmi lesquelles une « véritable politique partenariale avec les pays tiers et les organisations internationales », et préconisait « une implication beaucoup plus forte des pays tiers de premier accueil et de transit » pour une « protection dans les régions d’origine » [7]. Voilà l’externalisation de la politique européenne de gestion des frontières et les camps de demandeurs d’asile parés des atours de la protection grâce à la Commission européenne et au HCR. Un an plus tard, le programme de La Haye, adopté au Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004, associait bien logiquement le HCR aux programmes d’externalisation [8]. Telle sera désormais la partition jouée par l’UE, au travers d’une communication de la Commission qui prône le « renforcement des capacités de protection des régions d’origine » afin d’« améliorer l’accès à des solutions durables [9] ».
Les camps sans le mot
Si, une fois balayée la proposition britannique, il n’était plus question de parler de « camp » [10], c’est au profit d’un florilège de substituts politiquement corrects. Le ministre allemand de l’intérieur parle d’installer dans les pays riverains de la Méditerranée, ainsi qu’en Ukraine, des « centres d’accueil » où seraient examinées les demandes d’asile [11]. La France suggère « d’aider ponctuellement les pays d’Afrique du Nord en créant des “points d’accueil” [12] » où migrants et demandeurs d’asile seraient rassemblés et qui permettraient de renvoyer vers le pays d’origine les « faux » demandeurs d’asile « à peu de frais, puisqu’il se ferait en autocar, et non par avion » [13]. De leur côté, Italiens et Allemands lancent une proposition de « guichets européens de l’immigration » pour regrouper hors des frontières les candidats à l’immigration, tout en accordant une aide au développement aux pays « source » d’Afrique subsaharienne et un traitement « plus humain » de l’asile dans les pays de transit [14].
Au début de l’année 2005, la Commission européenne décidait d’affecter d’importants fonds européens pour « financer le renforcement de capacité de protection et d’accueil sur place, qui semble moins coûteux que l’accueil dans les centres de réfugiés installés dans des pays membres de l’UE ». Après l’Afrique du Nord, ce sont l’Afrique des grands lacs et la frontière orientale de l’UE, notamment l’Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie qui étaient visées. L’idée, officiellement présentée au début du mois de septembre 2005, était d’articuler la mise en place de « zones régionales de protection » à proximité des pays d’où partent les exilés pour qu’ils y trouvent un premier asile, avant d’éventuellement bénéficier de programmes de réinstallation dans un pays de l’UE [15]. Dans le cadre de ce partenariat, les pays ciblés pour faire office de zones d’attente avant le visa pour l’UE étaient pourtant loin d’être « sûrs » au regard des besoins de protection. Dans un rapport de novembre 2005, l’ONG Human Rights Watch montrait que les demandeurs d’asile et les migrants étaient soumis à des traitements inacceptables en Ukraine : détention prolongée, violences physiques et dans certains cas retour forcé dans le pays d’origine où ils risquaient tortures et persécutions [16]. Quant à la Biélorussie, c’est l’Union européenne elle-même qui, régulièrement, exprime sa préoccupation à propos des violations répétées des droits de l’Homme qui y sont pratiquées.
À ce jour, les projets européens de camps externalisés pour demandeurs d’asile n’ont jamais formellement abouti, tant pour des raisons techniques et juridiques [17] que par défaut d’accord entre États membres de l’UE. Malgré les annonces du mois de mars 2015, ces obstacles risquent d’empêcher que ces dispositifs soient opérationnels à court terme. Ils ne seraient de toute façon que la partie visible d’un processus depuis longtemps en marche, celui de l’évitement des réfugiés qui tient lieu de politique d’asile à l’Europe, à travers la coopération avec des pays qui ne sont pas choisis pour leur aptitude à « permettre l’accès à la protection » des réfugiés, mais pour leur capacité à jouer le rôle de tampon pour la protéger des indésirables.
L’externalisation, une idée vieille de 30 ans
|